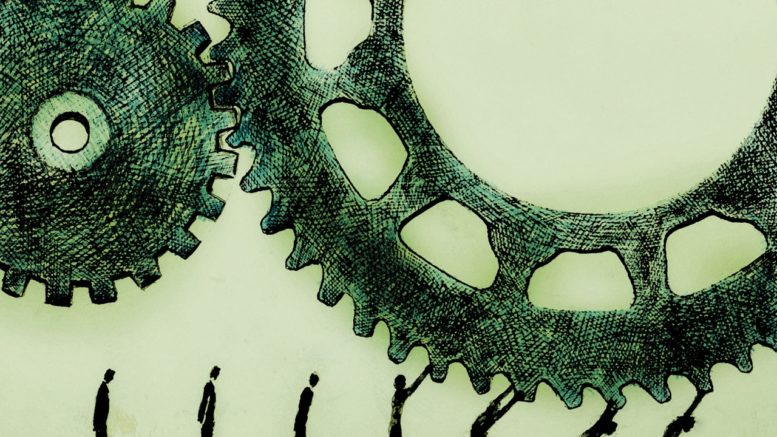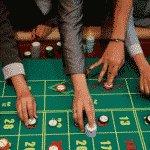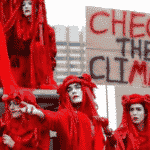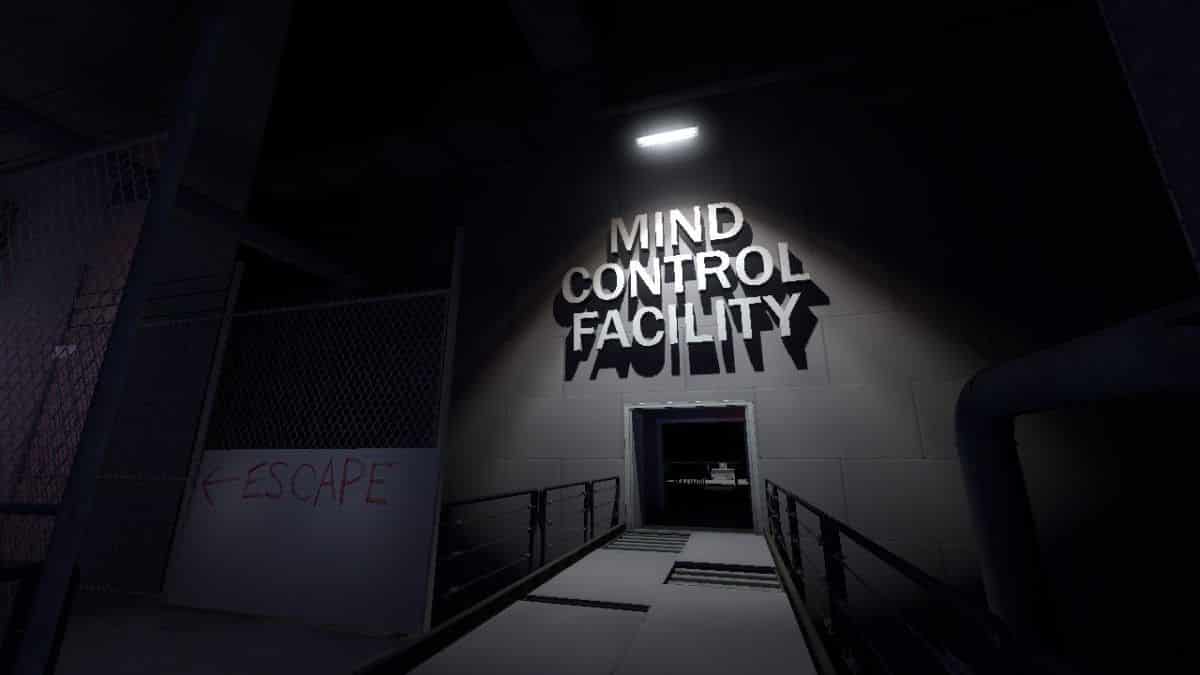Les services Premium Technocracy News & Trends sont réservés aux membres Premium Access. Vérifiez-le!
Articles connexes: